- Accueil
- Ressources en vapeur
- Théorie de la vapeur
- Coups de bélier: le mécanisme
Résoudre les problèmes liés aux purgeurs de vapeur
Coups de bélier: le mécanisme
Que sont les coups de bélier?
Avez-vous déjà entendu un gros bruit de claquement après avoir rapidement ouvert ou fermé un robinet d'eau? Si cela sonnait comme si la tuyauterie recevait un gros coup, c'était ce que l'on appelle des coups de bélier. Dans une usine, le démarrage ou l'arrêt d'une pompe ainsi que la fermeture subite d'un évent d'air pourrait occasionner ce problème.
À part les conduites d'eau, les coups de bélier surviennent aussi dans les circuits de vapeur et de récupération de condensât (c.-à-d. les circuits d'eau). La présente série d'articles se rapportera aux coups de bélier dans ces deux derniers cas.
Les dangers que posent les coups de bélier
Lorsque la vapeur est nouvellement fournie aux conduites ou aux installations lors de la mise en route, il arrive qu'un bruit de claquement métallique répétitif ou qu'un bruit d'explosion violent accompagné de vibrations soient entendus. La plupart des travailleurs utilisant la vapeur ont déjà probablement vécu ce scénario au moins une fois.
 Savez-vous comment sonnent les coups de bélier?
Savez-vous comment sonnent les coups de bélier?Ce sont des coups de bélier. Lorsqu'ils surviennent, un changement brusque de pression atteignant plus de 100 bar peut avoir lieu.
Le choc créé peut faire violemment trembler les conduites, l'équipement et l'encaissement des machines, ce qui pourrait endommager non seulement les joints d'étanchéité, mais aussi les brides et les vannes elles-mêmes.
 |
| Exemple de conduites endommagées par des coups de bélier |
Ce genre de dommage pourrait causer un accident grave si une grande quantité de vapeur ou de condensât chaud commence à jaillir hors des conduites, etc. On a même reporté des cas de mort suite à des accidents causés par les coups de bélier. Malgré cela, très peu de recherches ont été effectuées sur les causes et la prévention de ce problème et souvent les travailleurs utilisant la vapeur se trouvent dépourvus de solutions.
Endroits où se produisent les coups de bélier
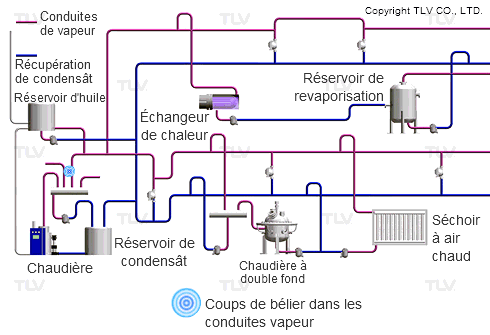
Coups de bélier: le mécanisme
Les coups de bélier qui surviennent dans les circuits de vapeur ou de récupération de condensât sont généralement classés en deux catégories:
- causés par des masses de condensât heurtant les tuyaux, etc. à grande vitesse
- causés par la condensâtion subite de vapeur, ce qui produit de grosses vagues de condensât qui se heurtent les unes contre les autres
Coups de bélier causés par des masses de condensât à grande vitesse
Les pertes de chaleur rayonnante provoquent la formation de condensât dans le conduites de transport de vapeur. La vapeur d'eau qui circule à grande vitesse dans ces conduites entraîne ce condensât et cause la formation de vagues. Cette agitation cause la formation graduelle de masses de condensât qui sont alors entraînées avec la vapeur. Le phénomène est comparable à la formation de grosses vagues sur la mer par de grands vents.
Des coups de bélier surviennent lorsque ces masses de condensât heurtent un joint ou une vanne alors qu'elles sont déplacées à grande vitesse à travers la tuyauterie.
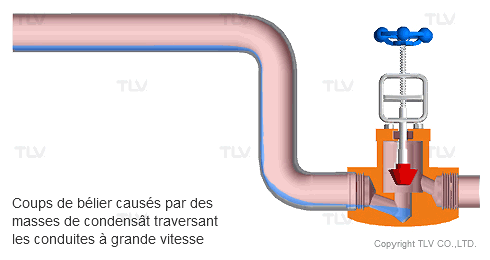
Coups de bélier causés par la condensâtion subite de vapeur
Lorsque la vapeur d'eau perd sa chaleur, elle se transforme en condensât. Son volume spécifique diminue alors d'un facteur de plus de mille. Ainsi, lorsque la vapeur se condense au contact avec du condensât plus froid, son volume est instantanément réduit à presque rien.
La réaction se fait à une telle vitesse qu'un vide est momentanément créé. L'attraction du condensât vers ce vide cause la seconde sorte de coups de bélier, causés par une condensâtion subite de vapeur.
En somme, il est dangereux de laisser les conduites contenir un mélange de condensât et de vapeur. C'est toutefois la norme dans les conduites de récupération de condensât ou autres conduites semblables, ce qui peut rendre la résolution du problème encore plus difficile.
Veuillez noter que ce dernier genre de coups de bélier n'est pas limité aux conduites de récupération de condensât, il peut aussi de produire dans les circuits de vapeur ou les installations utilisant la vapeur.
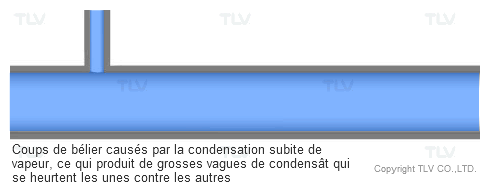
Les gros chocs pour lesquels sont souvent reconnus les coups de bélier se produisent dans les deux cas énumérés ci-haut, mais leur fréquence est beaucoup plus grande dans le second.
|
La vidéo ci-dessus réalisée par TLV présente l'effet de coups de bélier induit par la vapeur d'eau dans une tuyauterie de retour de condensât. Ce phénomène de coups de bélier peut se produire lorsque des poches de vapeur se condensent dans des lignes de récupération de condensât. |
Comment la température du condensât affecte-t-elle les coups de bélier?
Auparavant, on croyait que plus la température du condensât est basse, plus les chocs causés par les coups de bélier sont puissants. Toutefois, une série d'expériences effectuées chez TLV nous a appris autrement. On a découvert que les plus gros chocs sont produits à une température juste un peu inférieure à celle de la vapeur.
C'est-à dire que pour de la vapeur saturée à 100°C, le condensât causerait de plus gros chocs pour la zone de température entre 70 et 80°C que celle pour la zone de température 50 et 60°C.
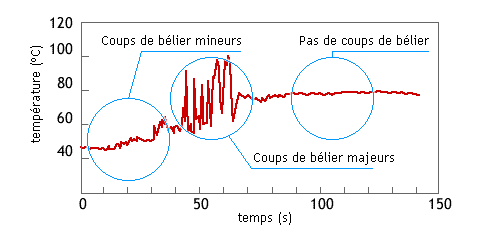
En effet, l'intensité des chocs causés par les coups de bélier peut être calculée de façon mathématique, et les résultats de ces calculs démontrent que l'intensité des coups de bélier est grandement affectée par la grosseur de la poche de vapeur qui se condense.
En examinant le graphique d'un peu plus près, on peut apercevoir trois zones de température de condensât:
- À la gauche, la vapeur d'eau entre en contact avec du condensât beaucoup plus froid et se condense immédiatement. La condensâtion se fait alors sur une échelle de petites bulles de vapeur. De grosses poches de vapeur ne sont pas formées et les coups de bélier qui surviennent sont mineurs.
- La zone au milieu du graphique est plus inquiétante. Dans cette zone de température, la condensâtion de la vapeur n'est pas immédiate étant donné l'écart de température de 20 ou 30°C entre la vapeur et le condensât. La condensâtion est plutôt graduelle au début pour ensuite survenir tout d'un coup lorsqu'une portion de la vapeur a été condensée. Le délai entre le stade où la vapeur entre en contact avec le condensât et celui où elle se condense tout d'un coup est propice à la formation de grosses poches de vapeur, ce qui cause les coups de bélier majeurs.
- À la droite, la vapeur entre en contact avec du condensât de même température. Dans ce cas, elle ne se condense pas immédiatement et aucun coup de bélier n'est produit. Ceci peut être attesté du fait que les coups de bélier ne surviennent pas près de la sortie d'un purgeur, là où se trouvent du condensât saturé et de la vapeur de revaporisation à la même température.
On peut donc conclure que du condensât entre 70 et 80 °C cause la production de plus grosses poches de vapeur et que la condensâtion subite de ces poches augmenterait l'intensité des coups de bélier. Qu'est-ce qui déclenche alors le procédé? Découvrez en plus en lisant l'article Coups de bélier: Établir le lieu et la cause.